La « guerre contre la drogue » menée par Trump dans les Caraïbes inquiète

Au cours des derniers mois, le président Donald Trump a transformé la mer des Caraïbes en théâtre de guerre.
Son administration a revendiqué la responsabilité de multiples frappes militaires contre des bateaux qui auraient transporté des stupéfiants depuis le Venezuela, se vantant d’avoir détruit des navires « narco-terroristes ». Ces opérations, menées par des avions et des navires de guerre de la marine américaine, ont fait au moins 32 morts, dont l’identité n’a pas été révélée et les crimes présumés n’ont pas été prouvés.
Explosions en mer, questions sur terre
Selon Trump, ces attaques s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle campagne visant à lutter contre le trafic de drogue et à empêcher le fentanyl et d’autres stupéfiants d’atteindre les côtes américaines. A ce jour, la Maison Blanche n’a toutefois fourni aucune preuve que les bateaux visés transportaient de la drogue, ni aucune explication sur les raisons pour lesquelles la garde côtière américaine, l’agence légalement chargée d’intercepter les trafiquants, a été contournée.
Pour Jim Jones, républicain et ancien procureur général de l’Idaho, cette politique relève davantage du spectacle que de la stratégie. « Les assassinats répétés de Trump dans les Caraïbes relèvent davantage de l’art performatif que de la nécessité militaire », a-t-il écrit dans une tribune libre publiée dans l’Idaho Capital Sun. Il a qualifié cette politique de « stupide », soulignant que le fait de faire exploser des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue détruit des preuves cruciales et prive les enquêteurs de la possibilité d’interroger les suspects ou de remonter la piste des réseaux d’approvisionnement. « Les suspects morts ne peuvent pas divulguer d’informations précieuses », a fait valoir M. Jones.
Au-delà de ses défauts tactiques, M. Jones a averti que cette pratique violait la loi américaine, puisque le Congrès n’a pas autorisé l’usage de la force létale, et le droit international, qui restreint les actions militaires contre les civils en dehors des zones de guerre déclarées.
Saper l’État de droit
Cette controverse a relancé le débat sur le contrôle civil de l’armée. Peu après son entrée en fonction, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a licencié plusieurs hauts juges-avocats généraux (JAG), les qualifiant d’« obstacles » à l’autorité présidentielle. Les officiers juridiques des forces armées veillent traditionnellement à ce que les ordres militaires soient conformes aux lois nationales et internationales. Leur licenciement, a suggéré Jones, montre que « Trump n’avait aucune intention de se conformer aux lois en vigueur ».
Citant George Washington, Jones a rappelé les paroles du premier président sur la discipline militaire : « Une armée sans ordre, sans régularité et sans discipline n’est pas meilleure qu’une foule commissionnée. » Selon lui, les actions de Trump placent les militaires américains dans une position intenable, les obligeant à exécuter des ordres potentiellement illégaux qui pourraient les exposer à la cour martiale ou à des poursuites internationales.
Les retombées ont déjà commencé. L’amiral Alvin Holsey, commandant du Commandement Sud des États-Unis et officier supervisant les opérations dans les Caraïbes, a annoncé une retraite anticipée inattendue. Un autre officier supérieur, le colonel Doug Krugman, a démissionné en invoquant le « mépris pour la Constitution » de Donald Trump.
Le fentanyl, le Venezuela et la géographie du blâme
La justification de l’administration Trump pour ces frappes meurtrières repose en grande partie sur une seule affirmation : le Venezuela serait devenu un important fournisseur de fentanyl, l’opioïde synthétique responsable de plus de 70 000 décès par overdose aux États-Unis l’année dernière. Mais les experts affirment que c’est faux.
Comme l’a rapporté Stuart Ramsay, correspondant de Sky News en Amérique latine, « il est tout simplement incorrect de blâmer le Venezuela pour la production de fentanyl ». M. Ramsay, qui couvre depuis des années les cartels mexicains, affirme que le fentanyl est synthétisé au Mexique à partir de précurseurs chimiques provenant de Chine, puis directement acheminé vers les États-Unis par la frontière sud. « Le Venezuela n’est pas impliqué de manière significative dans ce commerce de fentanyl », a souligné M. Ramsay.
Le Venezuela sert en revanche de pays de transit pour la cocaïne, dont une grande partie est produite dans les pays voisins, à savoir la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Les bateaux que les États-Unis ont pris pour cible dans leurs frappes transportent généralement de la cocaïne destinée non pas à la Floride ou au Texas, mais à Trinité-et-Tobago, à l’Afrique de l’Ouest et, finalement, à l’Europe.
« Le président Trump affirme que ces bateaux se dirigent vers les États-Unis », a déclaré Ramsay, « mais en réalité, ils se dirigent principalement vers l’Europe. »
Ce décalage entre le discours et la géographie alimente les soupçons selon lesquels la « guerre contre la drogue » pourrait servir de couverture à des objectifs politiques ou économiques. La présence de l’USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, au large des côtes vénézuéliennes n’a pas grand-chose à voir avec la lutte contre le trafic de stupéfiants, une mission généralement assurée par de petits patrouilleurs ou les garde-côtes. Pour de nombreux analystes, le véritable objectif semble être de faire pression sur le président Nicolás Maduro, dont le gouvernement socialiste reste un adversaire de longue date de Washington.
Une doctrine ancrée au Pentagone
Des documents obtenus par The Intercept révèlent que le Pentagone envisage depuis longtemps de jouer un rôle plus agressif dans les opérations de lutte contre le trafic de drogue. Un rapport publié en 2015 par l’Institute for Defense Analyses, commandé par le ministère de la Défense, recommandait une « action militaire directe » contre les organisations criminelles transnationales. Sur la base d’entretiens avec 62 trafiquants condamnés, dont des figures importantes des cartels, l’étude suggérait d’utiliser le « ciblage cinétique » – jargon militaire désignant la force létale – contre les têtes des cartels.
L’un des auteurs du rapport, l’ancien responsable de la DEA Joseph Keefe, a déclaré à The Intercept que cette idée était née pendant la guerre en Irak, lorsque les forces américaines ont commencé à considérer les insurgés et les trafiquants comme des « réseaux de méchants » similaires. Mais même Keefe, qui soutenait autrefois une coopération militaire limitée, a déclaré que les bombardements de bateaux de Trump allaient trop loin. « Travailler ensemble est utile, a-t-il déclaré, mais pas tuer tout le monde. »
Son coauteur, William Simpkins, ancien administrateur par intérim de la DEA à la retraite, est allé plus loin. « Faire exploser ce premier bateau est un assassinat extrajudiciaire, il faut le reconnaître », a-t-il déclaré. Simpkins a souligné que la plupart des personnes à bord de ces navires sont des passeurs de bas niveau, et non des chefs de cartels. « Même s’ils étaient membres de cette organisation, ils ne faisaient probablement pas partie des membres les plus importants. »
Ironiquement, le même rapport du Pentagone a mis en évidence la corruption, et non la puissance de feu, comme le principal facteur favorisant le trafic mondial de drogue. Presque tous les trafiquants interrogés ont déclaré que les pots-de-vin versés à la police, aux politiciens et aux responsables militaires étaient essentiels au bon fonctionnement de leurs opérations. Certains ont même détaillé les tarifs en vigueur : 10 000 dollars pour des informations sur les raids, 100 000 dollars pour être informé d’un mandat d’extradition, ou des millions pour acheter une protection contre les poursuites judiciaires.
De la guerre contre la drogue à la guerre contre la loi
L’offensive de Trump dans les Caraïbes semble combiner le discours de la lutte contre le terrorisme et les tactiques de changement de régime. En qualifiant les trafiquants de drogue et même les dirigeants étrangers de « narcoterroristes », l’administration revendique un large pouvoir légal pour recourir à la force, sans l’accord du Congrès.
Selon les experts, le flou entre criminalité et terrorisme fait entrer l’impunité de la guerre contre le terrorisme dans la lutte contre la drogue. « Importer de la drogue aux États-Unis est en soi un acte terroriste », a déclaré Trump sur son réseau social, Truth Social, après une frappe en septembre. Mais selon ses détracteurs, une telle logique transforme une question d’application de la loi en une guerre sans fin, sans grand effet sur le commerce réel de la drogue.
Au-delà de la légalité et de la stratégie se pose une question plus profonde : tout cela fonctionne-t-il ? Après des années d’opérations antidrogue militarisées, de la Colombie à l’Afghanistan, les flux mondiaux de stupéfiants restent largement inchangés. Même les anciens responsables de la DEA qui ont conseillé le Pentagone admettent que les États-Unis ne peuvent pas mettre fin à la toxicomanie par les bombes.
« Tant qu’il y aura de la demande, l’offre continuera d’affluer », a conclu Simpkins. « Enfermer tout le monde n’a pas résolu le problème. Faire exploser 11 personnes sur un bateau bringuebalant et minable ne le résoudra pas non plus. »
Pour Jones, le vétéran républicain de l’Idaho, la question est plus simple. « Il est peut-être temps pour lui d’arrêter d’enfreindre la loi et de commencer à la faire respecter », écrit-il.
Si les explosions dans les Caraïbes font de « belles » images, elles révèlent une vérité plus sombre : la guerre contre la drogue menée par les États-Unis est redevenue une guerre sans loi, sans but et sans fin.
-
Cannabis en Franceil y a 6 jours
La France sacrifie son industrie du chanvre CBD dans le budget 2026
-
Chanvreil y a 2 semaines
Des scientifiques découvrent des composés anticancéreux dans les racines du chanvre
-
Cancer et cannabisil y a 2 semaines
Le CBD présente un large potentiel antitumoral selon une nouvelle étude
-
Businessil y a 3 semaines
Cannabis Europa revient à Paris le 19 février 2026
-
Cannabis en Franceil y a 3 semaines
Frenchfarm lance un spray THC
-
Cannabinoïdesil y a 3 semaines
Des scientifiques néerlandais résolvent le mystère des origines du THC, du CBD et du CBC
-
Cannabis en Franceil y a 5 jours
La filière du chanvre CBD finalement sauvée par le 49.3
-
Businessil y a 2 semaines
L’Ohio dépasse le milliard de dollars de vente de cannabis pour sa première année de légalisation
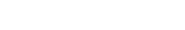


































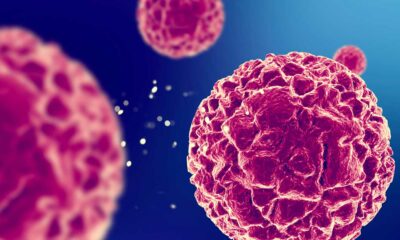










Vous devez être connectés pour poster un commentaire Connexion